2018
À BRAS LE CORPS - HEAD ON
Entretien
entre Yasmina Benabderrahmane et Adrien Genoudet
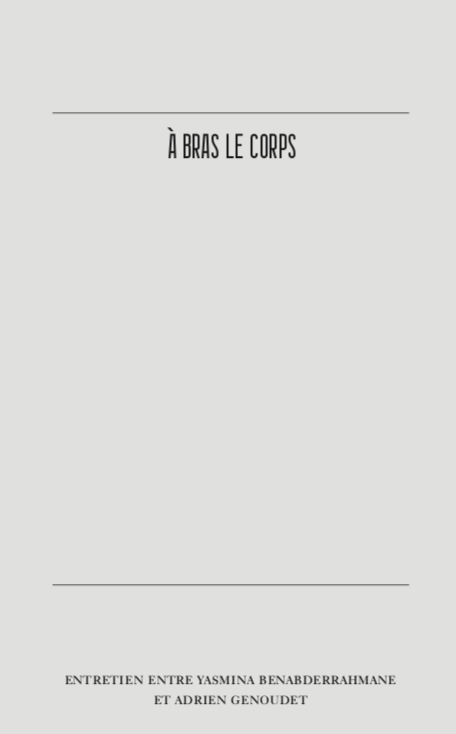




A.G Tu es revenue au Maroc pour la
première fois en 2012, après quatorze ans d’absence. Ce travail est le fruit
de plusieurs voyages, et tes images dessinent, en un sens, une cartographie
à la fois réelle et intime. D’un côté, elles présentent des personnages,
qui sont des membres de ta famille, et de l’autre, des lieux précis, avec
lesquels tu as un lien particulier.
Peux-tu revenir sur ton arrivée au Maroc et la découverte de « la Bête » ?
Y.B Dans les premiers temps, nous nous baladions, avec mon oncle et sa femme, dans la région de Rabat. Un jour, ils m’ont montré le site d’un immense projet, le Grand Théâtre, qui devait être édifié dans la vallée du Bouregreg. C’est une vallée connue sous le nom de Vallée des potiers, réputée inconstructible, car les marais rendent la terre meuble, instable, peu propice à l’édification de bâtiments. On sentait encore la trace de l’homme qui venait pren- dre l’argile de la vallée pour fabriquer les poteries, les plats à tagine et autres ornements. C’était beau, touchant, et il me paraissait improbable que quelque chose puisse être construit à cet endroit. Le laboratoire de recherche de mon oncle, qui est géologue et travaille pour l’État, a été chargé d’évaluer le terrain et de conceptualiser la solidification des sols tout en respectant le territoire. On ne peut pas s’implanter comme ça, car la terre vit. Alors ils ont fait venir une roche du Moyen-Orient pour durcir cette matière meuble et créer un nouveau terrain dans lequel l’eau pouvait encore passer et s’infiltrer. Je trouvais cette histoire assez incroyable. Je n’ai compris que plus tard que ce projet du Grand Théâtre avait été décidé par le Roi lui-même. Il avait demandé à Zaha Hadid d’en concevoir l’architecture et elle avait accepté. Le chantier a démarré en 2014 et, malheureusement, elle est morte durant la construction, en 2016. C’est donc sa dernière œuvre, une œuvre posthume, en quelque sorte.
A.G Tu n’avais donc pas un projet précis en tête quand tu y es retournée pour la première fois ?
Y.B Non, pas vraiment. Pour moi, ce voyage, c’était un peu un retour aux sources. J’ai eu envie d’enquêter sur mes origines, de comprendre d’où je viens, qui je suis. Vient un moment, à 30 ans, où tu as envie de savoir. J’ai dit à ma tante Hnia que j’aimerais retourner au Maroc et elle m’a dit : « Chiche ! On prend un billet et je t’emmène. » Être avec elle était important pour moi, elle était celle qui rendait possible le retour.
A.G Il y a donc, dans un premier temps, grâce à ton oncle, la découverte de cette vallée marquée par un chantier pharaonique, puis les retrouvailles avec ta famille, dans un village isolé de l’Atlas, lieu où est née et où a vécu ta grand-mère. Elle est devenue, d’ailleurs, un des personnages centraux de ton travail.
Y.B Nous ne nous étions pas retrouvées ensemble au Maroc depuis mes 5 ans. Nous sommes allées à Chichaoua, près de son village d’origine, chez sa grande sœur qui a 96 ans. Nous sommes arrivées au moment de l’Aïd.
Il y a un autre territoire qui est présent dans mon travail, c’est Imintanoute, une vallée ber- bère du Moyen-Atlas. Mon oncle y travaille de temps en temps, il expertise les types de roches pouvant servir à la fabrication du béton pour de futures implantations de carrières, pour la construction de ponts ou d’autres ouvrages. Il est très proche de cette terre berbère, il en con- naît depuis toujours les sols, les pierres.
A.G Cette question de la « matérialité » des lieux que tu filmes est essentielle dans ton tra vail, dominé par ce rapport avant tout sensible aux éléments. Étais-tu frappée par les lieux en tant que tels ou plutôt par ce qui était en train de s’y jouer ?
Y.B C’était une rencontre. Souvent, avec les lieux, c’est un peu comme avec les gens, j’y vais à tâtons. Je suis curieuse, comme un enfant, et je me laisse surprendre, sensible au temps qui traverse les espaces. La vallée du Bouregreg, je l’ai vue peu à peu s’altérer, être éven- trée, être jonchée ; le paysage être plus violenté de jour en jour. Et les habitants qui restent là, qui résistent, qui sont en lutte. Ils manifestent, ils disent : « Mais pour quoi faire ? Pourquoi un tel chantier ? Il y a déjà un théâtre à Rabat. » Après, tu comprends que le projet se fera envers et contre tout, car c’est la volonté du Roi.
Je me souviens aussi, dans les premiers temps, du silence. Quand je visitais le chantier, au début, tout était calme. J’y allais pendant les temps de pause ou durant le ramadan, les gens ne travail- laient pas, ils étaient en train de manger ou de prier. Autour du chantier, on pouvait voir de vastes terrains plats et nus, des routes récentes, des étendues très vides, immenses, rocailleuses. Un désert qui émergeait peu à peu de nulle part, puisque ce n’était pas un désert, avant. Des montagnes apparaissaient peu à peu, de plus en plus grandes, pyramidales, énormes. Tout était très sec, poudreux, sans eau. L’ensemble manquait de vie car les animaux étaient partis vivre ailleurs. Tout semblait un peu étrange et mes premiers films tentaient de rendre compte de cette étrangeté, de ces non-zones, des choses qui volaient, de la poussière, du silence.
A.G Donc, très vite, tu t’es mise à prendre des images ?
Y.B Oui, très vite. En 2012, j’ai redécouvert un pays que j’avais complètement oublié, qui avait complètement changé. Même les membres de ma famille, je ne les ai pas reconnus. Les premiers jours, je n’arrêtais pas de pleurer. La sœur de ma grand-mère disait que je les avais abandonnés, que je n’étais pas revenue. Au fond, je pense qu’elle s’adressait à ma mère... J’étais bouleversée. Tu ne vois grandir personne, c’est ça le plus terrible. Alors je me suis mise à tout filmer, à vouloir tout cristalliser. C’est ce marqueur, le temps qui passe sur les choses et sur les êtres, qui m’a donné l’impulsion. Enfant, je prenais beaucoup de photos. C’était une manière d’échanger avec le monde, d’être au monde. Cela m’aide aussi à voir à travers un filtre, un écran, un édifice de verre. Ces images font corps avec mon histoire, celle de ma famille. En les regardant, on voit que ma grand-mère a vécu simplement, en lien avec la tradition. Ayant été élevée par ma grand-mère, ce lien a beaucoup compté pour moi, même si nous habitions en France et non dans le pays où elle est née et a grandi.
A.G Le personnage de ta grand-mère, tel que tu le filmes, est aussi un personnage métaphorique. Elle incarne, à travers ses gestes, sa parole, le corps-témoin de la tradi- tion. Comment s’est-elle imposée comme « figure » centrale dans ton travail ?
Y.B Ma grand-mère m’a dit un jour : « Tu ne peux forcer personne à être filmé ou à pos er pour toi. Mais, moi, filme-moi, je n’ai rien à perdre. Je suis vieille. » Ma grand-mère est une personne très pieuse qui a un rapport au corps très pudique. Les seules parties de son corps que l’on peut voir sont ses pieds et ses mains. J’ai commencé à la filmer dans son quotidi- en. C’est venu tout simplement, comme un jeu. Ma grand-mère ne parle pas très bien français. Je comprends le marocain courant mais je le parle mal, parce que je n’ai pas vécu assez au Ma- roc pour en comprendre toutes les subtilités. Souvent, on me dit : « Mais Yasmina, qu’est-ce que tu dis ? Comment tu te comportes ? Tu ne peux pas faire ci ou ça. » Comme ma grand- mère est quelqu’un que j’aime, j’ai eu envie de capter tous ces moments, de les collecter, de sceller ce temps. Un geste très égoïste, finalement. Quelqu’un a récemment dit à ma mère : « Yasmina, elle vient, elle pille, elle filme tout ce qu’elle peut. » Mais, c’est autre chose pour moi. C’est partager un moment : quelqu’un va prendre soin de toi, et toi, en échange, tu vas lui donner ce que tu auras à lui donner.
A.G Le personnage de ton oncle est plus ambigu, plus complexe à appréhender. Géo- logue de formation, spécialiste du béton, il travaille pour l’État, il est, en quelque sorte, en charge de la bonne conduite du chantier. Tu le filmes en train de tester la fiabilité des sols, d’expertiser, de cartographier..., mais aussi lors de moments plus intimes, lorsqu’il fait ses ab- lutions et prie, ou lors de la fête de l’Aïd aux côtés de ta grand-mère, qui est sa mère. Lié à la tradition, il incarne aussi celui qui autorise et rend possibles les grands chantiers, la « main de la modernité ». Quels sont tes rapports avec lui ?
Y.B Mon oncle ne dit jamais non, selon les règles de l’hospitalité marocaine. Je suis sa nièce. Il est fier de moi, toujours content de me présenter à d’autres. Mais, même si j’étais bien reçue, personne ne comprenait vraiment ce que je voulais faire.
Mon oncle est le petit frère de ma mère. Il a fait de grandes études en France, il est docteur en géologie. Lors de sa soutenance de thèse, il disait qu’il voulait repartir : « Mon pays, c’est le Maroc. C’est le plus beau des pays et le paradis de la géologie. » Il a travaillé sur de nom- breux projets urbains comme l’agrandissement du réseau de tramway à Rabat. Aujourd’hui, il dirige un laboratoire de recherche qui quantifie et teste la fiabilité et la longévité du béton utilisé dans les chantiers. Le contrôle est fait à partir des échantillons des matières premières prélevés sur le site, un peu à l’ancienne, à partir de carottages, de machines qui les concassent. Le fait d’aménager la Vallée du Bouregreg ainsi, de dénaturer ce paysage avec tout ce béton, va à l’encontre de mes valeurs. Cependant la modernisation des infrastructures au Maroc est bénéfique par ailleurs. Il y a en effet de mauvaises routes, peu d’interconnexions entre les villages, un réseau hydraulique défaillant – certains villages n’ont pas l’eau courante... Dans la région où se trouve Imintanoute, on vient de détourner une rivière pour distribuer l’eau aux villageois, ce qui est essentiel. Je suis donc dans une sorte d’entre-deux...
A.G S’ils sont en un sens opposés dans leurs liens avec le Maroc contemporain, ton oncle et ta grand-mère ne sont pas des figures antithétiques, contraires ou inverses – ils se ren- contrent d’ailleurs dans les images que tu as prises lors de la fête de l’Aïd. Sont-ils pour toi deux figures, deux métaphores des différentes temporalités du Maroc ?
Y.B Cela reste, avant tout, la relation entre une mère et son enfant. Je pense ces deux per- sonnages plutôt comme une paire, l’un n’allant pas sans l’autre.
Lorsque j’évoque ce grand chantier, je parle souvent de deus ex machina, parce que tous ces bouleversements du paysage nous projettent dans un futur improbable, fantasmé. Ce qui m’in- téresse d’autant plus dans la construction d’un théâtre, c’est d’y voir, avec toutes ses entrées et sorties, côté jardin et côté cour, un peu comme une grande scène continue où se joueraient la vie et l’infra-vie. J’imagine des milliers de fourmis qui édifient, sur un immense terril, un ouvrage démesuré, hors d’échelle, imaginé par le Roi. Le travail du corps, sur un chantier comme celui-ci, reste, non pas inhumain, mais à la limite du surhumain. Même si la machine est là, le gros du travail est réalisé par les ouvriers, leurs corps et leurs gestes minuscules mis bout à bout. Et il en est de même, selon moi, pour les rites ancestraux. Pendant la fête traditionnelle de l’Aïd, j’ai filmé ma grand-mère et mon oncle « sacrifier » une bête – une bête sacrée. Tous deux, ils refont chaque année les mêmes gestes, précis et ancestraux, du Prophète. Ce rituel du sacrifice est ancré dans la vie des membres de ma famille. C’est un moment de partage. Et cette bête est nourricière, le moindre morceau est utilisé. Ce ne sont pas des mondes qui s’opposent, mais des traditions qui se complètent.
A.G J’aimerais savoir ce que tu penses de la notion d’intimité. Tes films en Super 8 sont à la fois marqués par une esthétique du fragment et, dans le même temps, dominés par des plans rapprochés, des détails de corps, d’objets ou d’éléments, qui viennent définir ou incarner la personne que tu filmes...
Y.B J’essaie, le plus possible, de me mettre à distance, de ne pas être démonstrative tout en filmant des choses liées à mon intimité et au quotidien de membres de ma famille. C’est un équilibre instable, fragile. Je veux aller là, je veux filmer ça, je n’arrête pas de m’imposer. Et en même temps, il se passe plein de choses hors-champ qui suscitent une certaine colère chez moi. Par exemple, mon petit-cousin est atteint d’une leucémie. Et ma grand-mère cuisine pour lui, pour qu’il soit bien nourri, pour qu’il aille mieux. Ces corps souffrants de mon petit-cousin et de ma grand-mère, qui est très âgée sont présents dans mon travail, mais de manière indi- recte. Je ne veux pas exhiber pour exhiber et dire pour dire. Mon état émotionnel trouve d’autres images pour s’exprimer, des images-relais, en quelque sorte.
A.G On touche ici à un point métaphorique de ton travail, qui est traversé, de bout en bout, par la double présence de la « bête » : à la fois la Bête en tant que chantier mécanique, moderne et dévoreur, et la bête traditionnelle, le mouton, que l’on sacrifie de génération en génération pour perpétuer le rite...
Y.B Tout le projet est marqué, depuis le début, par cette matière visqueuse, par cette présence de la chair et, petit à petit, des liens visuels vont s’établir avec les textures du chantier, la coulée du béton, le bitume fondu, la carapace du bâti... Un moment a vu la jonction réelle de ces éléments. En 2016, le chantier a été paralysé suite au décès soudain de l’architecte. Pour « conjurer le sort », les autorités ont fait sacrifier cent moutons et veaux blancs sur le site des travaux. On fait couler le sang pour purifier, contrairement à l’eau, qui est là pour féconder. Cette symbolique des fluides m’a beaucoup inspirée. Ce lien au sacré me plaît, j’ai grandi dans une famille très pieuse où il prenait naturellement place dans la gestuelle du quotidien, la mémoire des corps. J’ai choisi de le montrer par fragments pour lui donner une portée générale, presque universelle.
A.G Si tu filmes et photographies au plus près les membres de ta famille, à une échelle « micro », cela s’intègre aussi dans une dimension plus large – « macro » – de l’histoire du Maroc, à la fois prise entre la vie traditionnelle et la modernisation démesurée, parfois bru- tale, marquée par l’exploitation intensive des ressources et la bétonisation à outrance. Est-ce un point important pour toi, d’inscrire cette part quotidienne, intime et traditionnelle, dans quelque chose de plus large ? Cherches-tu à documenter la contemporanéité clivée du Maroc ?
Y.B En tant qu’artiste, il faut essayer de dire ces choses-là, sinon, qui peut le faire ? Je ne suis pas là pour établir une critique pure et simple, pour dénoncer frontalement. Je voudrais que cela soit suggéré, que celui qui regarde mon travail le perçoive, que ce clivage s’infiltre en lui et que cela devienne, pour lui, matière à penser. La disparité des richesses au Maroc est très frappante. Des gens extrêmement riches côtoient des gens dans un dénuement extrême. Persiste également une grande disparité entre les campagnes et les villes. Il y a énormément de bidonvilles. Des jeunes sniffent de la colle dans la rue, ils sont venus en ville pour vivre autre chose mais n’y ont rien trouvé. Tous les 200 mètres, quelqu’un mendie, malgré les limou- sines qui passent. On peut légitimement se demander pourquoi dépenser autant d’argent pour construire ce très beau théâtre, ce « mall culturel » qui va abriter un nouveau musée d’archéol- ogie sur l’histoire de cette terre, alors que l’immense majorité des marocains ne peut même pas se payer un billet d’entrée. Toutes les familles qui vivaient dans la vallée du Bouregreg ont été déplacées, les autorités leur ont donné de l’argent pour qu’elles partent vivre ailleurs. Donc, bien sûr, l’histoire de ce chantier est marquée par le politique, par le pouvoir. À ma grande sur- prise, quand j’ai débuté les prises de vue, je pense avoir été approchée par les services secrets du Maroc qui m’ont posé des questions très politiques, très précises. Une fois, mon oncle m’a dit : « Yasmina, tu resteras une espionne car tu viens filmer dans un pays qui n’est pas le tien, tu diffuseras des informations visuelles et sonores. Peu importe la forme que cela prendra, où cela sera diffusé, malgré toi, tu resteras une espionne... » Tous les artistes que j’ai rencontrés au Maroc font le même constat : c’est un très beau pays, très riche, relativement ouvert, mais la place de la création est toujours traversée par les luttes d’hier et d’aujourd’hui.
A.G Et quand tu vois cela, tu n’as pas envie prendre ta caméra, de filmer, de documenter cette réalité-là ?
Y.B Non, cela me paraît trop dur, trop difficile. Je suis comme choquée, tétanisée, voire même agressée. Et il y a la barrière de la langue. Je ne comprends pas l’arabe littéraire. Alors, je suis là, je reçois, j’assimile. Je suis dans le sensible, je cherche ce qui, dans le réel, se sédimente en moi avec le temps. Je ne suis pas dans le cinéma direct. Sinon, j’aurais été jour- naliste ou anthropologue. Affronter le monde par métaphores est ma façon à moi de résister. Je pars de mon cercle familial ou intime, car me confronter d’emblée à une dimension plus large ne me convient pas. Tout, pour moi, se passe à cette échelle. J’opère une forme de transposition, de la cellule au tout.
A.G Tu travailles en argentique et sur pellicule. Quel est ton rapport à la matérialité des images ?
Y.B Je travaille sur pellicule parce que j’aime utiliser un support avec lequel je n’ai pas besoin de rechercher la perfection de l’image. Il y a toujours un risque que cela ne marche pas. J’aime capter sans savoir si cela va rester ou pas. L’échange avec la personne que je filme tient la place la plus importante dans le processus ; ce qui a pour conséquence que je mets beaucoup de temps à développer, car je préfère en garder le souvenir plutôt que d’en voir le résultat. J’ai tellement peur qu’il n’y ait rien que je préfère attendre et oublier ce que j’ai fait pour mieux le redécouvrir par la suite. Je suis aussi très attachée à la pellicule car je peux développer, bidouiller, voiler cette surface sensible... c’est un matériau vivant dans sa fragilité et sa membrane vibrante permet toutes sortes d’expérimentations. Au moment du développe- ment en Super 8, des griffures ou des poussières viennent sur la pellicule sans que l’on puisse rien maîtriser. Tout cela est très corporel, tactile, aléatoire, et je compare souvent la pellicule du film à une peau, sensible à la lumière, marquée par les traces de ce qu’elle a vécu.
A.G Comment expliques-tu ton choix d’utiliser parfois de la couleur ou du noir et blanc ? Ont-ils pour toi une dimension symbolique ?
Y.B Tourner en noir et blanc me permet de créer un lien avec le dessin par le grain tout en ayant un rendu sculptural. Et puis, il y a autre chose : lorsque le sujet filmé m’évo- que la douceur, j’ai envie d’atteindre quelque chose de plus dur et de plus brut, dans ce cas, j’ai aussi recours au noir et blanc. On est dans une valeur temporelle « neutre », qui confère une dimension d’archive aux images. Pour certaines, je n’ai pas envie qu’elles marquent clairement hier, aujourd’hui ou demain. J’aime ce qui crée le trouble. Dans Opération Béton de Godard, tourné en 1953, il y a des plans quasi similaires à ceux que j’ai tournés sur le chantier. On retro- uve les mêmes machines, les mêmes types de tapis roulants, de processus mécaniques... J’aime bien le fait que le spectateur s’interroge, qu’il se demande si ces images du Grand Théâtre appartiennent vraiment au régime contemporain de représentation d’une utopie architecturale. L’image, pour moi, comme la réalité, doit demeurer une énigme. Une énigme non anodine.
A.G En plus des questions liées au développement, à la couleur ou au tirage, tu joues avec les formats, les échelles et parfois les recadrages. On peut ajouter à cela ton travail de montage, qu’il soit à la fois sur les films, dans la séquence du livre et dans l’espace de l’exposition.
Que cherches-tu par la multiplication des formats et des échelles ?
Y.B Le rapport au grain, au gros plan, m’intéresse car il vient perturber la vision, donner une matérialité nouvelle et, parfois, révéler des motifs inattendus, imperceptibles dans un autre format. Je cherche cet effet sculptural de l’image qui fait qu’une main devient un pay- sage et qu’une pierre peut devenir un visage. Je cherche à susciter du corps là où il n’y en a pas. Par exemple, dans cette image que j’ai appelée « le téton », qui est en fait un simple écrou tournant sur lui-même. Pour moi, il devient une figure hypnotique qui ne fait que tourner ou s’arrêter abruptement. J’aime le déplacement du regard qui trouve de la sensualité, de l’absurde, du burlesque dans la vibration d’un rouage, le frémissement d’une toile ou l’écoulement de gravats. Mon regard se focalise instinctivement, comme celui d’un enfant, sur ce qui se meut, s’anime, s’agite. Je suis attirée par ce corps-machine qui a parfois des gestes très doux. Même s’il semble à première vue mâcher, casser, arracher, déplacer, etc., on a aussi l’impression qu’il caresse ; tout est dans notre sensibilité extrême aux êtres et aux choses.
Peux-tu revenir sur ton arrivée au Maroc et la découverte de « la Bête » ?
Y.B Dans les premiers temps, nous nous baladions, avec mon oncle et sa femme, dans la région de Rabat. Un jour, ils m’ont montré le site d’un immense projet, le Grand Théâtre, qui devait être édifié dans la vallée du Bouregreg. C’est une vallée connue sous le nom de Vallée des potiers, réputée inconstructible, car les marais rendent la terre meuble, instable, peu propice à l’édification de bâtiments. On sentait encore la trace de l’homme qui venait pren- dre l’argile de la vallée pour fabriquer les poteries, les plats à tagine et autres ornements. C’était beau, touchant, et il me paraissait improbable que quelque chose puisse être construit à cet endroit. Le laboratoire de recherche de mon oncle, qui est géologue et travaille pour l’État, a été chargé d’évaluer le terrain et de conceptualiser la solidification des sols tout en respectant le territoire. On ne peut pas s’implanter comme ça, car la terre vit. Alors ils ont fait venir une roche du Moyen-Orient pour durcir cette matière meuble et créer un nouveau terrain dans lequel l’eau pouvait encore passer et s’infiltrer. Je trouvais cette histoire assez incroyable. Je n’ai compris que plus tard que ce projet du Grand Théâtre avait été décidé par le Roi lui-même. Il avait demandé à Zaha Hadid d’en concevoir l’architecture et elle avait accepté. Le chantier a démarré en 2014 et, malheureusement, elle est morte durant la construction, en 2016. C’est donc sa dernière œuvre, une œuvre posthume, en quelque sorte.
A.G Tu n’avais donc pas un projet précis en tête quand tu y es retournée pour la première fois ?
Y.B Non, pas vraiment. Pour moi, ce voyage, c’était un peu un retour aux sources. J’ai eu envie d’enquêter sur mes origines, de comprendre d’où je viens, qui je suis. Vient un moment, à 30 ans, où tu as envie de savoir. J’ai dit à ma tante Hnia que j’aimerais retourner au Maroc et elle m’a dit : « Chiche ! On prend un billet et je t’emmène. » Être avec elle était important pour moi, elle était celle qui rendait possible le retour.
A.G Il y a donc, dans un premier temps, grâce à ton oncle, la découverte de cette vallée marquée par un chantier pharaonique, puis les retrouvailles avec ta famille, dans un village isolé de l’Atlas, lieu où est née et où a vécu ta grand-mère. Elle est devenue, d’ailleurs, un des personnages centraux de ton travail.
Y.B Nous ne nous étions pas retrouvées ensemble au Maroc depuis mes 5 ans. Nous sommes allées à Chichaoua, près de son village d’origine, chez sa grande sœur qui a 96 ans. Nous sommes arrivées au moment de l’Aïd.
Il y a un autre territoire qui est présent dans mon travail, c’est Imintanoute, une vallée ber- bère du Moyen-Atlas. Mon oncle y travaille de temps en temps, il expertise les types de roches pouvant servir à la fabrication du béton pour de futures implantations de carrières, pour la construction de ponts ou d’autres ouvrages. Il est très proche de cette terre berbère, il en con- naît depuis toujours les sols, les pierres.
A.G Cette question de la « matérialité » des lieux que tu filmes est essentielle dans ton tra vail, dominé par ce rapport avant tout sensible aux éléments. Étais-tu frappée par les lieux en tant que tels ou plutôt par ce qui était en train de s’y jouer ?
Y.B C’était une rencontre. Souvent, avec les lieux, c’est un peu comme avec les gens, j’y vais à tâtons. Je suis curieuse, comme un enfant, et je me laisse surprendre, sensible au temps qui traverse les espaces. La vallée du Bouregreg, je l’ai vue peu à peu s’altérer, être éven- trée, être jonchée ; le paysage être plus violenté de jour en jour. Et les habitants qui restent là, qui résistent, qui sont en lutte. Ils manifestent, ils disent : « Mais pour quoi faire ? Pourquoi un tel chantier ? Il y a déjà un théâtre à Rabat. » Après, tu comprends que le projet se fera envers et contre tout, car c’est la volonté du Roi.
Je me souviens aussi, dans les premiers temps, du silence. Quand je visitais le chantier, au début, tout était calme. J’y allais pendant les temps de pause ou durant le ramadan, les gens ne travail- laient pas, ils étaient en train de manger ou de prier. Autour du chantier, on pouvait voir de vastes terrains plats et nus, des routes récentes, des étendues très vides, immenses, rocailleuses. Un désert qui émergeait peu à peu de nulle part, puisque ce n’était pas un désert, avant. Des montagnes apparaissaient peu à peu, de plus en plus grandes, pyramidales, énormes. Tout était très sec, poudreux, sans eau. L’ensemble manquait de vie car les animaux étaient partis vivre ailleurs. Tout semblait un peu étrange et mes premiers films tentaient de rendre compte de cette étrangeté, de ces non-zones, des choses qui volaient, de la poussière, du silence.
A.G Donc, très vite, tu t’es mise à prendre des images ?
Y.B Oui, très vite. En 2012, j’ai redécouvert un pays que j’avais complètement oublié, qui avait complètement changé. Même les membres de ma famille, je ne les ai pas reconnus. Les premiers jours, je n’arrêtais pas de pleurer. La sœur de ma grand-mère disait que je les avais abandonnés, que je n’étais pas revenue. Au fond, je pense qu’elle s’adressait à ma mère... J’étais bouleversée. Tu ne vois grandir personne, c’est ça le plus terrible. Alors je me suis mise à tout filmer, à vouloir tout cristalliser. C’est ce marqueur, le temps qui passe sur les choses et sur les êtres, qui m’a donné l’impulsion. Enfant, je prenais beaucoup de photos. C’était une manière d’échanger avec le monde, d’être au monde. Cela m’aide aussi à voir à travers un filtre, un écran, un édifice de verre. Ces images font corps avec mon histoire, celle de ma famille. En les regardant, on voit que ma grand-mère a vécu simplement, en lien avec la tradition. Ayant été élevée par ma grand-mère, ce lien a beaucoup compté pour moi, même si nous habitions en France et non dans le pays où elle est née et a grandi.
A.G Le personnage de ta grand-mère, tel que tu le filmes, est aussi un personnage métaphorique. Elle incarne, à travers ses gestes, sa parole, le corps-témoin de la tradi- tion. Comment s’est-elle imposée comme « figure » centrale dans ton travail ?
Y.B Ma grand-mère m’a dit un jour : « Tu ne peux forcer personne à être filmé ou à pos er pour toi. Mais, moi, filme-moi, je n’ai rien à perdre. Je suis vieille. » Ma grand-mère est une personne très pieuse qui a un rapport au corps très pudique. Les seules parties de son corps que l’on peut voir sont ses pieds et ses mains. J’ai commencé à la filmer dans son quotidi- en. C’est venu tout simplement, comme un jeu. Ma grand-mère ne parle pas très bien français. Je comprends le marocain courant mais je le parle mal, parce que je n’ai pas vécu assez au Ma- roc pour en comprendre toutes les subtilités. Souvent, on me dit : « Mais Yasmina, qu’est-ce que tu dis ? Comment tu te comportes ? Tu ne peux pas faire ci ou ça. » Comme ma grand- mère est quelqu’un que j’aime, j’ai eu envie de capter tous ces moments, de les collecter, de sceller ce temps. Un geste très égoïste, finalement. Quelqu’un a récemment dit à ma mère : « Yasmina, elle vient, elle pille, elle filme tout ce qu’elle peut. » Mais, c’est autre chose pour moi. C’est partager un moment : quelqu’un va prendre soin de toi, et toi, en échange, tu vas lui donner ce que tu auras à lui donner.
A.G Le personnage de ton oncle est plus ambigu, plus complexe à appréhender. Géo- logue de formation, spécialiste du béton, il travaille pour l’État, il est, en quelque sorte, en charge de la bonne conduite du chantier. Tu le filmes en train de tester la fiabilité des sols, d’expertiser, de cartographier..., mais aussi lors de moments plus intimes, lorsqu’il fait ses ab- lutions et prie, ou lors de la fête de l’Aïd aux côtés de ta grand-mère, qui est sa mère. Lié à la tradition, il incarne aussi celui qui autorise et rend possibles les grands chantiers, la « main de la modernité ». Quels sont tes rapports avec lui ?
Y.B Mon oncle ne dit jamais non, selon les règles de l’hospitalité marocaine. Je suis sa nièce. Il est fier de moi, toujours content de me présenter à d’autres. Mais, même si j’étais bien reçue, personne ne comprenait vraiment ce que je voulais faire.
Mon oncle est le petit frère de ma mère. Il a fait de grandes études en France, il est docteur en géologie. Lors de sa soutenance de thèse, il disait qu’il voulait repartir : « Mon pays, c’est le Maroc. C’est le plus beau des pays et le paradis de la géologie. » Il a travaillé sur de nom- breux projets urbains comme l’agrandissement du réseau de tramway à Rabat. Aujourd’hui, il dirige un laboratoire de recherche qui quantifie et teste la fiabilité et la longévité du béton utilisé dans les chantiers. Le contrôle est fait à partir des échantillons des matières premières prélevés sur le site, un peu à l’ancienne, à partir de carottages, de machines qui les concassent. Le fait d’aménager la Vallée du Bouregreg ainsi, de dénaturer ce paysage avec tout ce béton, va à l’encontre de mes valeurs. Cependant la modernisation des infrastructures au Maroc est bénéfique par ailleurs. Il y a en effet de mauvaises routes, peu d’interconnexions entre les villages, un réseau hydraulique défaillant – certains villages n’ont pas l’eau courante... Dans la région où se trouve Imintanoute, on vient de détourner une rivière pour distribuer l’eau aux villageois, ce qui est essentiel. Je suis donc dans une sorte d’entre-deux...
A.G S’ils sont en un sens opposés dans leurs liens avec le Maroc contemporain, ton oncle et ta grand-mère ne sont pas des figures antithétiques, contraires ou inverses – ils se ren- contrent d’ailleurs dans les images que tu as prises lors de la fête de l’Aïd. Sont-ils pour toi deux figures, deux métaphores des différentes temporalités du Maroc ?
Y.B Cela reste, avant tout, la relation entre une mère et son enfant. Je pense ces deux per- sonnages plutôt comme une paire, l’un n’allant pas sans l’autre.
Lorsque j’évoque ce grand chantier, je parle souvent de deus ex machina, parce que tous ces bouleversements du paysage nous projettent dans un futur improbable, fantasmé. Ce qui m’in- téresse d’autant plus dans la construction d’un théâtre, c’est d’y voir, avec toutes ses entrées et sorties, côté jardin et côté cour, un peu comme une grande scène continue où se joueraient la vie et l’infra-vie. J’imagine des milliers de fourmis qui édifient, sur un immense terril, un ouvrage démesuré, hors d’échelle, imaginé par le Roi. Le travail du corps, sur un chantier comme celui-ci, reste, non pas inhumain, mais à la limite du surhumain. Même si la machine est là, le gros du travail est réalisé par les ouvriers, leurs corps et leurs gestes minuscules mis bout à bout. Et il en est de même, selon moi, pour les rites ancestraux. Pendant la fête traditionnelle de l’Aïd, j’ai filmé ma grand-mère et mon oncle « sacrifier » une bête – une bête sacrée. Tous deux, ils refont chaque année les mêmes gestes, précis et ancestraux, du Prophète. Ce rituel du sacrifice est ancré dans la vie des membres de ma famille. C’est un moment de partage. Et cette bête est nourricière, le moindre morceau est utilisé. Ce ne sont pas des mondes qui s’opposent, mais des traditions qui se complètent.
A.G J’aimerais savoir ce que tu penses de la notion d’intimité. Tes films en Super 8 sont à la fois marqués par une esthétique du fragment et, dans le même temps, dominés par des plans rapprochés, des détails de corps, d’objets ou d’éléments, qui viennent définir ou incarner la personne que tu filmes...
Y.B J’essaie, le plus possible, de me mettre à distance, de ne pas être démonstrative tout en filmant des choses liées à mon intimité et au quotidien de membres de ma famille. C’est un équilibre instable, fragile. Je veux aller là, je veux filmer ça, je n’arrête pas de m’imposer. Et en même temps, il se passe plein de choses hors-champ qui suscitent une certaine colère chez moi. Par exemple, mon petit-cousin est atteint d’une leucémie. Et ma grand-mère cuisine pour lui, pour qu’il soit bien nourri, pour qu’il aille mieux. Ces corps souffrants de mon petit-cousin et de ma grand-mère, qui est très âgée sont présents dans mon travail, mais de manière indi- recte. Je ne veux pas exhiber pour exhiber et dire pour dire. Mon état émotionnel trouve d’autres images pour s’exprimer, des images-relais, en quelque sorte.
A.G On touche ici à un point métaphorique de ton travail, qui est traversé, de bout en bout, par la double présence de la « bête » : à la fois la Bête en tant que chantier mécanique, moderne et dévoreur, et la bête traditionnelle, le mouton, que l’on sacrifie de génération en génération pour perpétuer le rite...
Y.B Tout le projet est marqué, depuis le début, par cette matière visqueuse, par cette présence de la chair et, petit à petit, des liens visuels vont s’établir avec les textures du chantier, la coulée du béton, le bitume fondu, la carapace du bâti... Un moment a vu la jonction réelle de ces éléments. En 2016, le chantier a été paralysé suite au décès soudain de l’architecte. Pour « conjurer le sort », les autorités ont fait sacrifier cent moutons et veaux blancs sur le site des travaux. On fait couler le sang pour purifier, contrairement à l’eau, qui est là pour féconder. Cette symbolique des fluides m’a beaucoup inspirée. Ce lien au sacré me plaît, j’ai grandi dans une famille très pieuse où il prenait naturellement place dans la gestuelle du quotidien, la mémoire des corps. J’ai choisi de le montrer par fragments pour lui donner une portée générale, presque universelle.
A.G Si tu filmes et photographies au plus près les membres de ta famille, à une échelle « micro », cela s’intègre aussi dans une dimension plus large – « macro » – de l’histoire du Maroc, à la fois prise entre la vie traditionnelle et la modernisation démesurée, parfois bru- tale, marquée par l’exploitation intensive des ressources et la bétonisation à outrance. Est-ce un point important pour toi, d’inscrire cette part quotidienne, intime et traditionnelle, dans quelque chose de plus large ? Cherches-tu à documenter la contemporanéité clivée du Maroc ?
Y.B En tant qu’artiste, il faut essayer de dire ces choses-là, sinon, qui peut le faire ? Je ne suis pas là pour établir une critique pure et simple, pour dénoncer frontalement. Je voudrais que cela soit suggéré, que celui qui regarde mon travail le perçoive, que ce clivage s’infiltre en lui et que cela devienne, pour lui, matière à penser. La disparité des richesses au Maroc est très frappante. Des gens extrêmement riches côtoient des gens dans un dénuement extrême. Persiste également une grande disparité entre les campagnes et les villes. Il y a énormément de bidonvilles. Des jeunes sniffent de la colle dans la rue, ils sont venus en ville pour vivre autre chose mais n’y ont rien trouvé. Tous les 200 mètres, quelqu’un mendie, malgré les limou- sines qui passent. On peut légitimement se demander pourquoi dépenser autant d’argent pour construire ce très beau théâtre, ce « mall culturel » qui va abriter un nouveau musée d’archéol- ogie sur l’histoire de cette terre, alors que l’immense majorité des marocains ne peut même pas se payer un billet d’entrée. Toutes les familles qui vivaient dans la vallée du Bouregreg ont été déplacées, les autorités leur ont donné de l’argent pour qu’elles partent vivre ailleurs. Donc, bien sûr, l’histoire de ce chantier est marquée par le politique, par le pouvoir. À ma grande sur- prise, quand j’ai débuté les prises de vue, je pense avoir été approchée par les services secrets du Maroc qui m’ont posé des questions très politiques, très précises. Une fois, mon oncle m’a dit : « Yasmina, tu resteras une espionne car tu viens filmer dans un pays qui n’est pas le tien, tu diffuseras des informations visuelles et sonores. Peu importe la forme que cela prendra, où cela sera diffusé, malgré toi, tu resteras une espionne... » Tous les artistes que j’ai rencontrés au Maroc font le même constat : c’est un très beau pays, très riche, relativement ouvert, mais la place de la création est toujours traversée par les luttes d’hier et d’aujourd’hui.
A.G Et quand tu vois cela, tu n’as pas envie prendre ta caméra, de filmer, de documenter cette réalité-là ?
Y.B Non, cela me paraît trop dur, trop difficile. Je suis comme choquée, tétanisée, voire même agressée. Et il y a la barrière de la langue. Je ne comprends pas l’arabe littéraire. Alors, je suis là, je reçois, j’assimile. Je suis dans le sensible, je cherche ce qui, dans le réel, se sédimente en moi avec le temps. Je ne suis pas dans le cinéma direct. Sinon, j’aurais été jour- naliste ou anthropologue. Affronter le monde par métaphores est ma façon à moi de résister. Je pars de mon cercle familial ou intime, car me confronter d’emblée à une dimension plus large ne me convient pas. Tout, pour moi, se passe à cette échelle. J’opère une forme de transposition, de la cellule au tout.
A.G Tu travailles en argentique et sur pellicule. Quel est ton rapport à la matérialité des images ?
Y.B Je travaille sur pellicule parce que j’aime utiliser un support avec lequel je n’ai pas besoin de rechercher la perfection de l’image. Il y a toujours un risque que cela ne marche pas. J’aime capter sans savoir si cela va rester ou pas. L’échange avec la personne que je filme tient la place la plus importante dans le processus ; ce qui a pour conséquence que je mets beaucoup de temps à développer, car je préfère en garder le souvenir plutôt que d’en voir le résultat. J’ai tellement peur qu’il n’y ait rien que je préfère attendre et oublier ce que j’ai fait pour mieux le redécouvrir par la suite. Je suis aussi très attachée à la pellicule car je peux développer, bidouiller, voiler cette surface sensible... c’est un matériau vivant dans sa fragilité et sa membrane vibrante permet toutes sortes d’expérimentations. Au moment du développe- ment en Super 8, des griffures ou des poussières viennent sur la pellicule sans que l’on puisse rien maîtriser. Tout cela est très corporel, tactile, aléatoire, et je compare souvent la pellicule du film à une peau, sensible à la lumière, marquée par les traces de ce qu’elle a vécu.
A.G Comment expliques-tu ton choix d’utiliser parfois de la couleur ou du noir et blanc ? Ont-ils pour toi une dimension symbolique ?
Y.B Tourner en noir et blanc me permet de créer un lien avec le dessin par le grain tout en ayant un rendu sculptural. Et puis, il y a autre chose : lorsque le sujet filmé m’évo- que la douceur, j’ai envie d’atteindre quelque chose de plus dur et de plus brut, dans ce cas, j’ai aussi recours au noir et blanc. On est dans une valeur temporelle « neutre », qui confère une dimension d’archive aux images. Pour certaines, je n’ai pas envie qu’elles marquent clairement hier, aujourd’hui ou demain. J’aime ce qui crée le trouble. Dans Opération Béton de Godard, tourné en 1953, il y a des plans quasi similaires à ceux que j’ai tournés sur le chantier. On retro- uve les mêmes machines, les mêmes types de tapis roulants, de processus mécaniques... J’aime bien le fait que le spectateur s’interroge, qu’il se demande si ces images du Grand Théâtre appartiennent vraiment au régime contemporain de représentation d’une utopie architecturale. L’image, pour moi, comme la réalité, doit demeurer une énigme. Une énigme non anodine.
A.G En plus des questions liées au développement, à la couleur ou au tirage, tu joues avec les formats, les échelles et parfois les recadrages. On peut ajouter à cela ton travail de montage, qu’il soit à la fois sur les films, dans la séquence du livre et dans l’espace de l’exposition.
Que cherches-tu par la multiplication des formats et des échelles ?
Y.B Le rapport au grain, au gros plan, m’intéresse car il vient perturber la vision, donner une matérialité nouvelle et, parfois, révéler des motifs inattendus, imperceptibles dans un autre format. Je cherche cet effet sculptural de l’image qui fait qu’une main devient un pay- sage et qu’une pierre peut devenir un visage. Je cherche à susciter du corps là où il n’y en a pas. Par exemple, dans cette image que j’ai appelée « le téton », qui est en fait un simple écrou tournant sur lui-même. Pour moi, il devient une figure hypnotique qui ne fait que tourner ou s’arrêter abruptement. J’aime le déplacement du regard qui trouve de la sensualité, de l’absurde, du burlesque dans la vibration d’un rouage, le frémissement d’une toile ou l’écoulement de gravats. Mon regard se focalise instinctivement, comme celui d’un enfant, sur ce qui se meut, s’anime, s’agite. Je suis attirée par ce corps-machine qui a parfois des gestes très doux. Même s’il semble à première vue mâcher, casser, arracher, déplacer, etc., on a aussi l’impression qu’il caresse ; tout est dans notre sensibilité extrême aux êtres et aux choses.
